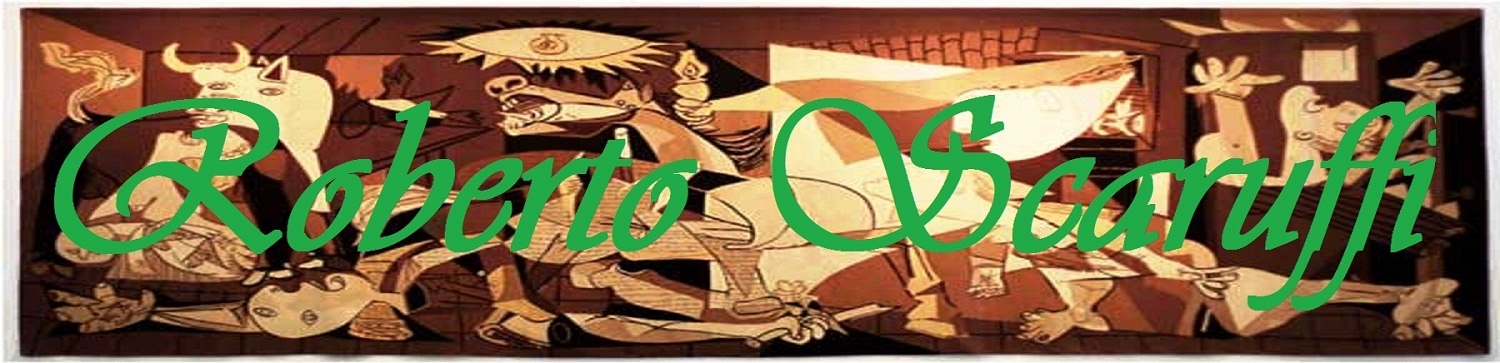23 novembre 2011
Révolution égyptienne, acte II
par
Alain Gresh
Je voudrais, avant de commencer ce texte, faire un appel à ses lecteurs.
Comme vous le savez, le blog « Nouvelles d'Orient » comme de nombreuses
publications sur ce site ne sont possibles que parce que « Le Monde
diplomatique » existe et finance ces activités. Comme tous les ans, nous faisons
appel aux dons des lecteurs pour
aider et consolider notre indépendance. Je vous invite à y participer, dans la
mesure de vos moyens, et à relayer cet appel autour de vous.
Les prévisions les plus pessimistes étaient devenues monnaie courante. Après le printemps venait l'automne arabe, la contre-révolution était en marche, et, pour certains, la révolution n'avait même pas eu lieu. Ce sentiment était sans doute d'autant plus prégnant que le renversement des régimes tunisien et égyptien s'était opéré avec une apparente facilité, créant l'illusion que les transformations seraient simples. Dès que le processus sembla ralenti, les augures annoncèrent que la révolution avait perdu. Pourtant, toute l'histoire des révolutions, de la révolution anglaise à la révolution française, de la révolution bolchevik à la révolution algérienne, prouve que les transformations nécessitent du temps, de l'énergie, souvent des affrontements violents. Rarement les classes dominantes cèdent sans combattre. Mais si la contre-révolution est une réalité, rien n'indique qu'elle doive nécessairement l'emporter.
La chute du président Hosni Moubarak n'avait été qu'une première étape, suivie de la nomination d'un nouveau gouvernement, puis de l'arrestation du président et de membres de sa famille et du début de leur procès, dont le conseil suprême des forces armées (CSFA) ne voulait pas. D'autres mesures avaient été imposées par la rue, notamment la dissolution du Parti national démocratique (PND, le parti de Moubarak), puis la nomination d'une direction provisoire au syndicat officiel.
Mais, partout, les responsables de l'ancien régime luttaient pied à pied pour maintenir leurs privilèges. L'exemple le plus frappant était celui des médias d'Etat, presse officielle et télévision. Malgré quelques petits changements, ces médias diffusaient le point de vue du CSFA, n'hésitant pas à user du mensonge et de la calomnie, comme du temps de l'ancien président. Dans chaque entreprise, dans chaque université, dans chaque administration, se maintenaient aussi des « petits Moubarak » qui avaient participé aux malversations de l'ancien régime. Et partout des grèves et des luttes se multipliaient pour obtenir à la fois le changement de direction et une amélioration des conditions de vie des salariés. D'autant que les mobilisations ouvrières avaient préparé l'actuelle révolution (lire Raphaël Kempf, « Racines ouvrières du soulèvement égyptien », Le Monde diplomatique, mars 2011).
Parallèlement, les élections dans divers syndicats professionnels amenaient de profonds changements dans des organisations qui ont un poids réel dans la société. D'abord le syndicat des médecins : les Frères musulmans, tout en gardant la majorité au niveau national, perdaient le contrôle de la majorité des sections régionales. Ils emportaient les élections du syndicat des enseignants (je n'ai pas pu obtenir les résultats exacts), mais perdaient aussi la présidence du syndicat des journalistes, et surtout celle du puissant syndicat des avocats. Plus que les revers (parfois relatifs) des Frères, c'était la forte participation à tous ces scrutins qui indiquait la volonté des adhérents de voir ces organisations jouer un rôle combattif. (...)
Les prévisions les plus pessimistes étaient devenues monnaie courante. Après le printemps venait l'automne arabe, la contre-révolution était en marche, et, pour certains, la révolution n'avait même pas eu lieu. Ce sentiment était sans doute d'autant plus prégnant que le renversement des régimes tunisien et égyptien s'était opéré avec une apparente facilité, créant l'illusion que les transformations seraient simples. Dès que le processus sembla ralenti, les augures annoncèrent que la révolution avait perdu. Pourtant, toute l'histoire des révolutions, de la révolution anglaise à la révolution française, de la révolution bolchevik à la révolution algérienne, prouve que les transformations nécessitent du temps, de l'énergie, souvent des affrontements violents. Rarement les classes dominantes cèdent sans combattre. Mais si la contre-révolution est une réalité, rien n'indique qu'elle doive nécessairement l'emporter.
La chute du président Hosni Moubarak n'avait été qu'une première étape, suivie de la nomination d'un nouveau gouvernement, puis de l'arrestation du président et de membres de sa famille et du début de leur procès, dont le conseil suprême des forces armées (CSFA) ne voulait pas. D'autres mesures avaient été imposées par la rue, notamment la dissolution du Parti national démocratique (PND, le parti de Moubarak), puis la nomination d'une direction provisoire au syndicat officiel.
Mais, partout, les responsables de l'ancien régime luttaient pied à pied pour maintenir leurs privilèges. L'exemple le plus frappant était celui des médias d'Etat, presse officielle et télévision. Malgré quelques petits changements, ces médias diffusaient le point de vue du CSFA, n'hésitant pas à user du mensonge et de la calomnie, comme du temps de l'ancien président. Dans chaque entreprise, dans chaque université, dans chaque administration, se maintenaient aussi des « petits Moubarak » qui avaient participé aux malversations de l'ancien régime. Et partout des grèves et des luttes se multipliaient pour obtenir à la fois le changement de direction et une amélioration des conditions de vie des salariés. D'autant que les mobilisations ouvrières avaient préparé l'actuelle révolution (lire Raphaël Kempf, « Racines ouvrières du soulèvement égyptien », Le Monde diplomatique, mars 2011).
Parallèlement, les élections dans divers syndicats professionnels amenaient de profonds changements dans des organisations qui ont un poids réel dans la société. D'abord le syndicat des médecins : les Frères musulmans, tout en gardant la majorité au niveau national, perdaient le contrôle de la majorité des sections régionales. Ils emportaient les élections du syndicat des enseignants (je n'ai pas pu obtenir les résultats exacts), mais perdaient aussi la présidence du syndicat des journalistes, et surtout celle du puissant syndicat des avocats. Plus que les revers (parfois relatifs) des Frères, c'était la forte participation à tous ces scrutins qui indiquait la volonté des adhérents de voir ces organisations jouer un rôle combattif. (...)
Lire
la suite de cet article de Alain Gresh :
Sur le site
-
L'Egypte caméra au poing
22/11. Le lac des signes
Christophe Baconin -
Gérard Longuet dans le texte
18/11. Défense en ligne
Philippe Leymarie -
Un Tsigane n'est pas tous les Tsiganes
16/11. Visions cartographiques
Cécile Kovacshazy -
« 55 % des Français »
15/11. Régime d'opinion
Alain Garrigou -
Dans les prisons égyptiennes
15/11. Nouvelles d'Orient
Alain Gresh -
Le Nicaragua sandiniste persiste et signe
10/11. La valise diplomatique
Maurice Lemoine -
Scandale à Paris : le livre dont les médias ne parlent pas !
08/11. La valise diplomatique