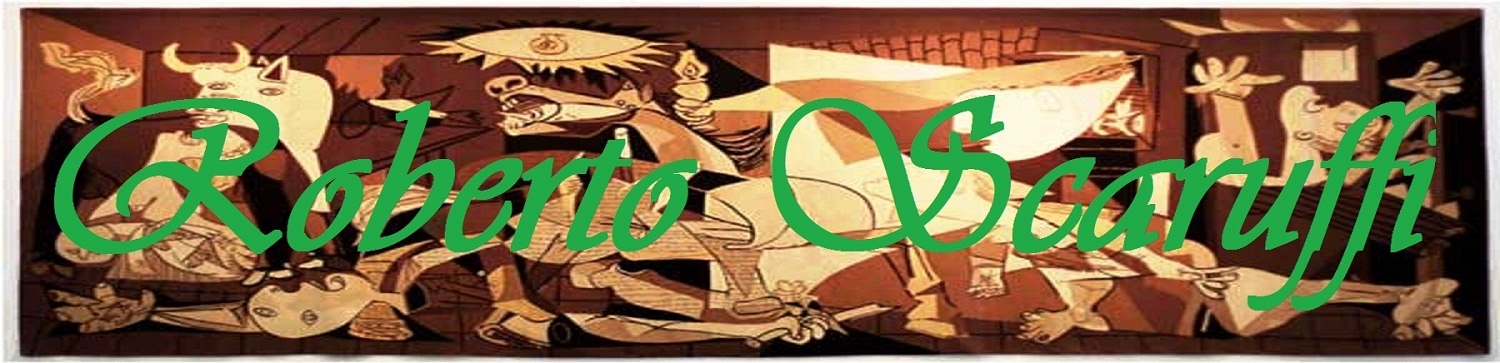Le dinar libyen
La
nouvelle agression des puissances militaires occidentales contre la
Libye et le monde arabe fournit quelques confirmations et quelques
nouveaux enseignements. Parmi les conformations : l’hypocrisie impérialiste de
l’Europe qui avec cette guerre enterre le partenariat
euro-méditerranéen qu’elle avait proclamé ; la vocation toujours
renaissante au colonialisme socialiste de la gauche européenne poussée
par un instinct de chacal à pouvoir puiser dans le dividende politique
des interventions militaires (la rhétorique nationaliste de l’hymne et
du drapeau) pour faire tomber le gouvernement Berlusconi ; l’inutilité
d’une Constitution qui comme c’est le cas aussi pour le « travail », la «
participation » et l’ « équité sociale » (nous évitons le mot « justice
» qui est trop déshonoré), révèle une fois de plus combien les
déclarations de principe sur la « répudiation de la guerre » (art. 11 de
la Constitution ) peuvent librement et impérieusement être étendues par
le président de la république à des initiatives des organisations
internationales vouées non pas à cette fin mais à légitimer des
initiatives « de guerre ».
Mais
les nouveautés les plus intéressantes se trouvent sur le plan de
l’économie. Au cours des dernières années face à une situation
économique et sociale aigue, face aux graves déficits démocratiques
auxquels on a affaire en Europe, aux nombreux épisodes d’économie
criminelle gérés par des systèmes financiers et bancaires nationaux et
internationaux, on nous a expliqué de façon récurrente qu’on ne pouvait
rien faire, parce que l’ « économie de marché » ne permet pas
d’interventions sur les marchés et sur la finance : nous aurions
épouvanté les marchés, les investissements. Intervenir
sur des institutions comme les bourses ou avec le contrôle politique
démocratique des banques centrales, n’était même pas pensable, si ce
n’est chez des utopistes comme Federico Caffè et quelques rares autres.
Qu’est-il
arrivé avec la « crise libyenne », qui est en réalité un complot pour
exproprier ce pays de ses propres richesses, tout comme ont été un
complot les récentes crises financières ? Nous avons tout d’un coup
découvert qu’on peut, techniquement et politiquement, exproprier et
geler d’énormes capitaux investis dans des entreprises et déposés dans
les banques en en définissant avec certitude la provenance, la
localisation et les appartenances. Ceci aussi, évidemment, peut
épouvanter les investisseurs publics et privés d’autres pays qui
auraient déposé leurs capitaux dans les banques européennes. Mais on
peut le faire. Et on l’a fait par « sentiment » de justice envers un
groupe de révoltés d’une province d’un Etat ami desquels par ailleurs
nous ne savons que très peu de choses (et ce que nous savons est
inquiétant parce que manœuvré de l’étranger). Donc nous avons maintenant
appris que l’Etat peut geler et exproprier des capitaux pour des
raisons de « justice ». Par exemple pour protéger les citoyens grecs ou
italiens des vols de la finance. Ou peut-être les millions d’Européens
réduits à la misère ne méritent-ils pas la même solidarité que les « insurgés de Bengazi » ?
Mais
nous avons appris beaucoup plus grâce à l’engagement opéré par un
économiste connu, Alberto Quadrio Curzio, sur le Corriere della Sera (20
mars 2011, p. 34). Selon l’économiste la guerre offre de grandes
perspectives de bien-être aux pays arabes si bien que le sommet qui a
décidé la guerre a aussi prévu de grands projets économico financiers
pour le Moyen Orient, avec un « Programme de Démocratie et de Prospérité
». Etrange parce que c’est depuis 1995, avec l’Accord de Barcelone avec
les pays arabes, qu’on parle de prospérité partagée mais on n’a jamais
trouvé de sous.
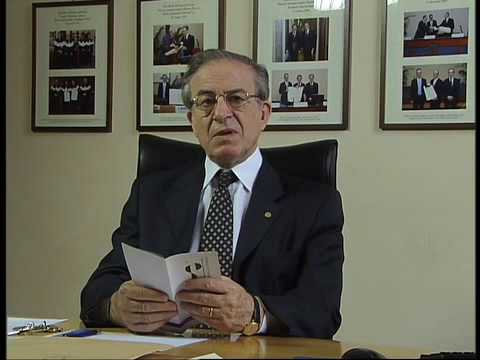
Alberto Quadrio Curzio
Mais
il semble que maintenant on peut en trouver. Voyons comment. Gelons,
comme nous l’avons fait pour l’argent de la Libye, les capitaux des pays
arabes et mettons-les dans une belle Banque pour le Développement
(c’est la proposition ici simplifiée), que, quand même, nous
administrons nous à Rome ensemble avec les gouvernements arabes amis (je
ne simplifie pas). Et ainsi, de cette gestion « commune » du pétrole
des arabes, des sous des arabes et de leurs marchés nous créerons une
zone de prospérité dont jouiront, évidemment,
aussi les européens en évitant les risques de projets d’autonomie
politique et économique que quelques inconséquents comme Kadhafi pourraient solliciter dans le monde arabe. Naturellement
le cerveau de tout ça seraient les systèmes financiers et bancaires
européens, dont nous connaissons la transparence et la crédibilité
politique.
En somme, un joli plan financier qui nous fait mieux comprendre les raisons de la guerre qui risquaient de rester obscures.
Edition de samedi 26 mars 2001 de il manifesto
Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio
Bruno Amoroso est économiste et enseigne l'économie au Federico Caffè Study Center, Roskilde (Danemark), à La Sapienza (Rome) et à l'université d'Hanoi (Vietnam).